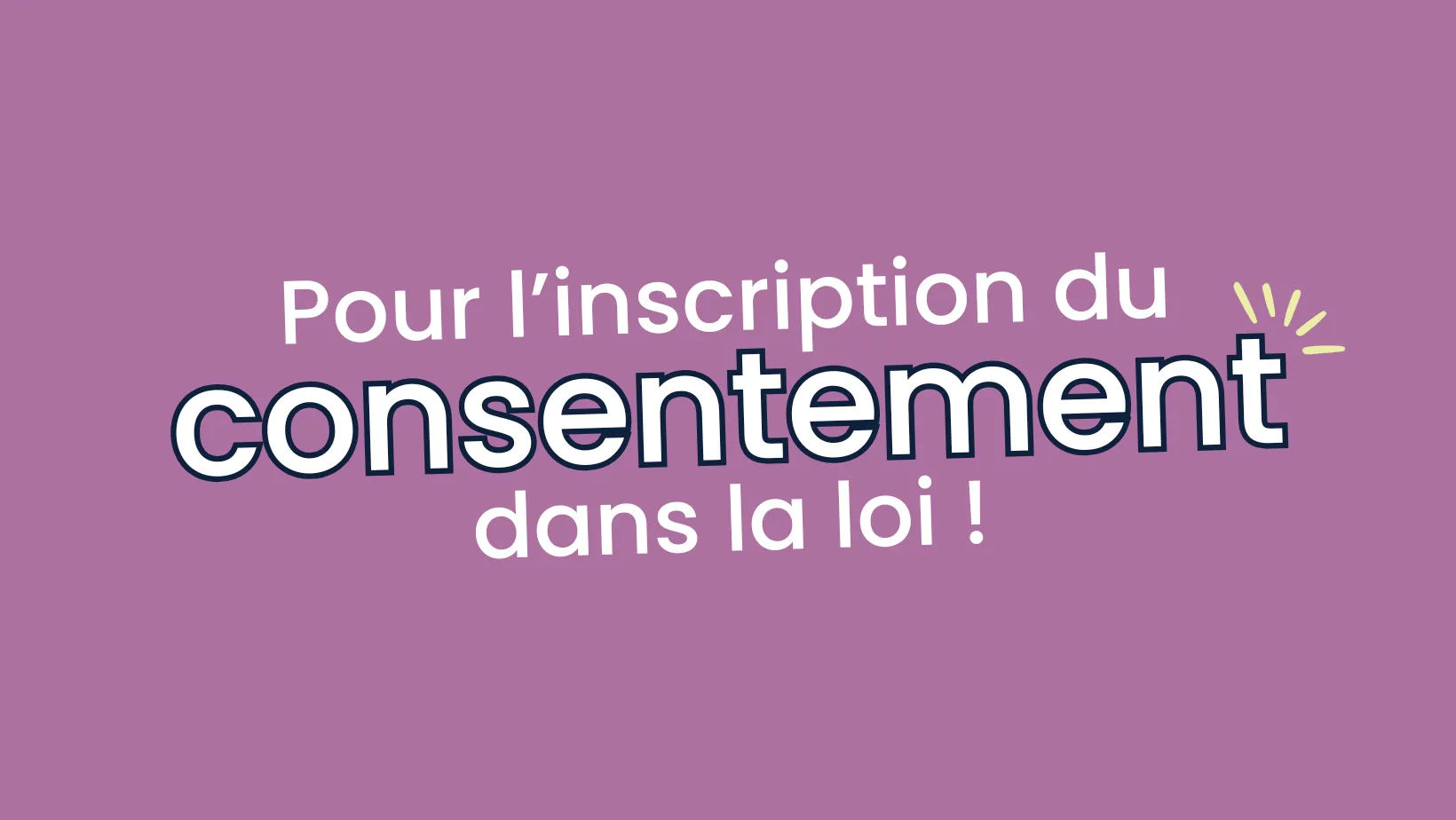Les discussions autour de la redéfinition pénale du viol et l’introduction de la notion de consentement agitent le débat public depuis déjà plusieurs années, et se sont retrouvées sur le devant de la scène à l’occasion du très médiatisé procès Pélicot.
Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Que pourrait changer une modification de la loi sur les violences sexuelles ?
Un peu d’histoire !
La tradition juridique française est très fortement marquée par le Code civil napoléonien de 1804. Guidé par une volonté de prendre le contrepied du mouvement émancipateur amorcé dans le cadre de la Révolution, le texte est profondément patriarcal et consacre l’infériorité des femmes face aux hommes, déclarant ces dernières “soumises à leur époux”, dans toutes les sphères de leur existence.
Le code pénal de 1810 n’incrimine pas le viol en tant que tel, se contentant de condamner les “attentats à la pudeur”. C’est la loi du 28 avril 1832 qui prévoit pour la première fois une infraction spécifique, mais sans la définir laissant au juge et à la doctrine la responsabilité de déterminer ce qu’était un viol. L’infraction visait alors « la conjonction charnelle d’un homme avec une femme, contre le gré ou sans le consentement de celle-ci« .
Ainsi, pendant de nombreuses décennies, la jurisprudence a considéré que le viol n’était que la pénétration forcée du sexe d’une femme par le sexe d’un homme. Il n’était retenu que lorsque l’homme avait fait usage de la violence. Le viol n’était alors possible qu’en dehors du mariage. Plusieurs évolutions, insufflées notamment par la mobilisation du mouvement féministe, ont permis de reconnaitre et de criminaliser le viol, aujourd’hui défini comme “tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise”.
Le dernier en date : le 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour avoir prononcé un divorce pour faute aux torts exclusifs d’une femme au motif qu’elle refusait des relations sexuelles avec son mari, considérant que cette consécration anachronique du “devoir conjugal” était incompatible avec l’article 8 de la CEDH (respect de la vie privée et familiale).
Aujourd’hui, où en est la loi sur le viol ?
Dans notre code pénal actuel, le viol est défini selon les critères de “violence, menace, contrainte et surprise”. Fruit d’une longue évolution en grande partie motivée par la mobilisation de la société civile sur ces sujets, la définition actuelle du viol a le mérite de pointer du doigt certaines stratégies mises en place par l’agresseur. Elle comporte toutefois des limites et de nombreuses situations passent encore aujourd’hui sous les radars de la loi.
En janvier 2025, les députées Marie Charlotte Garin et Véronique Riotton ont déposé un rapport d’information parlementaire sur la définition pénale du viol, rappelant le chiffre alarmant des 73% de classement sans suite des plaintes déposées pour cette infraction, alors même qu’environ 8 victimes sur 10 ne portent pas plainte.
Les deux députées ont déposé, dans la foulée, une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol en y intégrant la notion de consentement. Le texte, sur lequel le Conseil d’Etat a rendu un avis favorable le 6 mars dernier, sera examinée en commission des lois le 1er avril prochain.
Changer la loi, mais pourquoi ?
Nous en sommes convaincu·es, pour changer de système, il faut d’abord changer la loi. Il faut inscrire dans le marbre qu’un rapport sexuel non librement consenti est un viol et que la zone grise n’existe pas. Céder ce n’est pas consentir.
“Le consentement je l’ai pris de son mari”, avait déclaré l’un des accusés du procès Pélicot pour sa défense. Le corps des femmes n’est pas à disposition des hommes. Le consentement n’appartient à personne d’autre que soi.
Faire évoluer la définition pénale du viol doit permettre de changer de paradigme. Il s’agit de remettre au centre la question du consentement.
On ne peut pas compter uniquement sur la jurisprudence : faute de définition légale du consentement, la Cour de cassation s’interdit d’harmoniser la jurisprudence des juridictions inférieures en faisant du défaut de consentement une simple « question de fait appréciée souverainement par les juges du fond ». Ces interprétations fluctuantes créent une insécurité juridique et un traitement disparate des affaires de viol et d’agressions sexuelles sur le territoire, entraînant ainsi un accès inégal des victimes à leurs droits et une condamnation hétérogène des agresseurs.
Par ailleurs, modifier le code pénal pour intégrer la notion de consentement comporte un enjeu de conformité avec le droit international, et notamment avec la Convention d’Istanbul. Le rapport Grevio, le rapport de la CEDAW ainsi que la CNCDH demandent à la France d’opérer ce changement de législation.
Évidemment, changer la loi ne résoudra pas tout. C’est néanmoins un premier pas.
Pourtant, des inquiétudes et idées reçues quant à la possibilité de cette redéfinition perdurent.
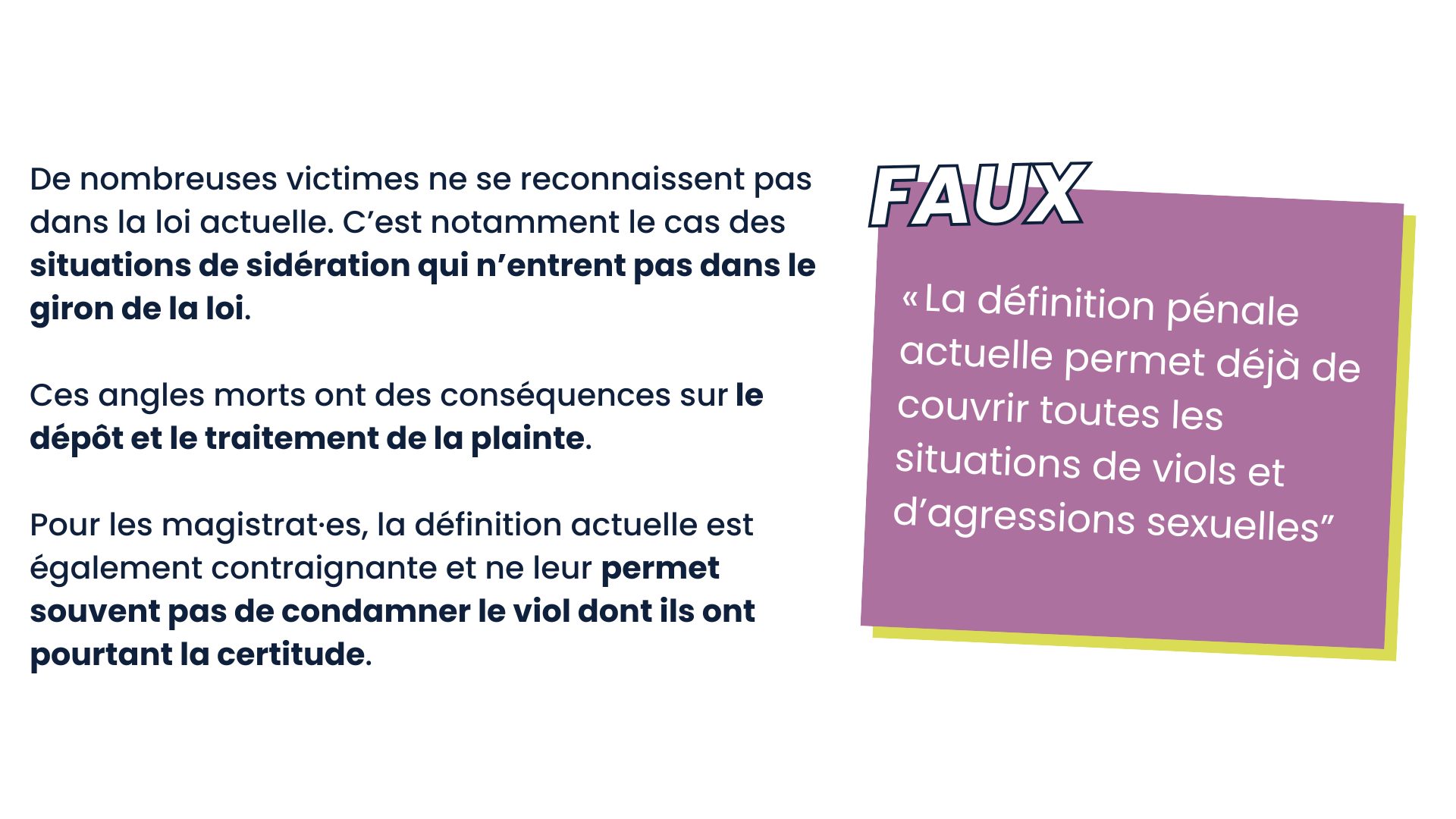
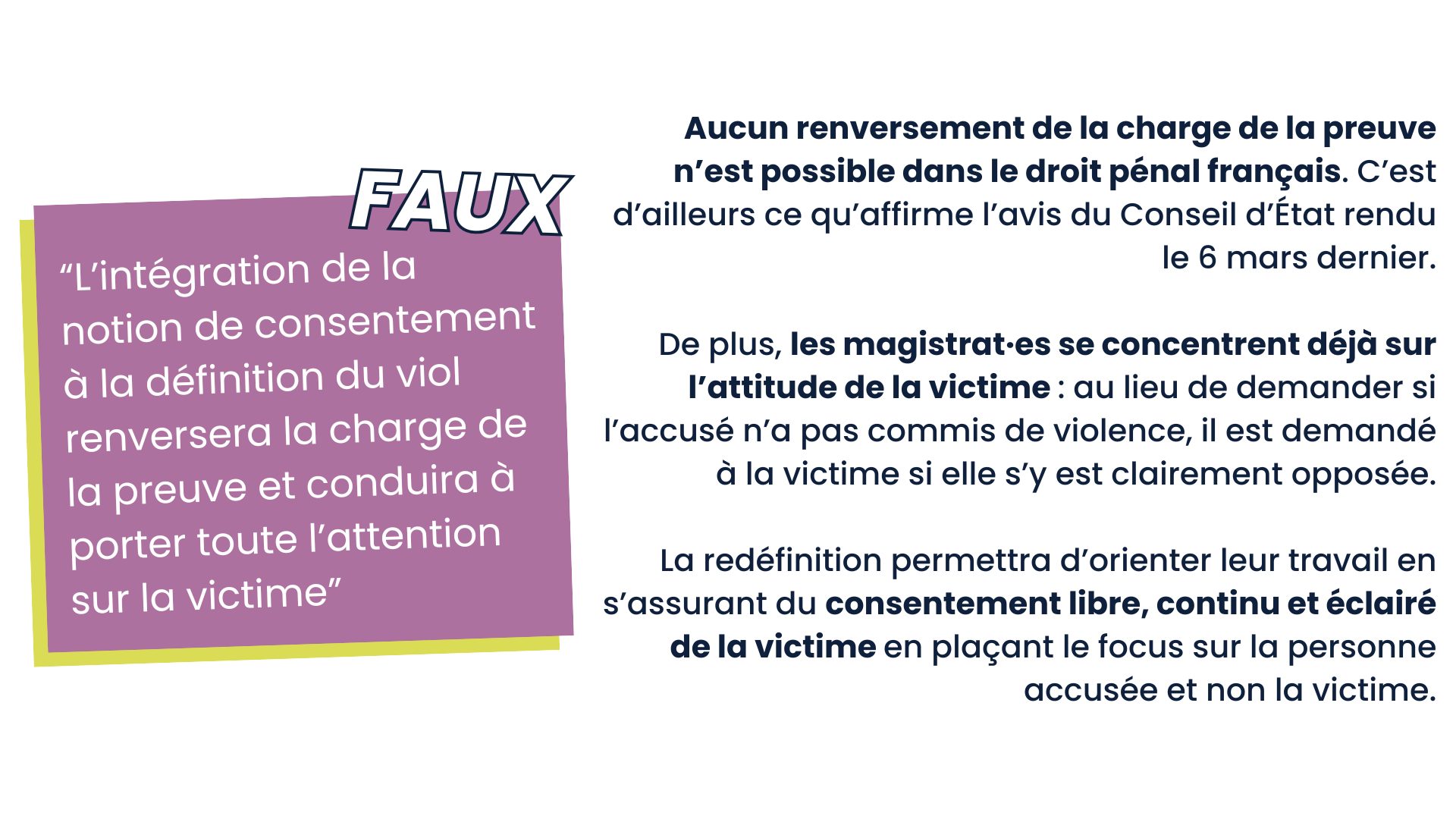
Comment se mobiliser ?
Le 1er avril prochain, la proposition de redéfinition pénale du viol sera examinée à l’Assemblée nationale.
En amont des débats, mobilisons nous largement devant l’Assemblée nationale pour faire entendre nos voix en faveur d’une redéfinition pénale du viol intégrant la notion de consentement !
RDV mardi 1er avril à 17h devant l’Assemblée nationale !
En attendant, vous pouvez également interpeller vos élu·es locaux et les appeler à lutter véritablement contre les violences sexistes et sexuelles en votant favorablement à la proposition de loi visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol.